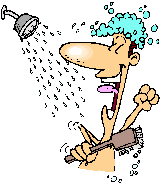|

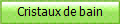



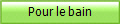
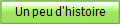






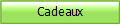
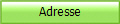

LIEN AMICAL

|
Paris Xe arrondissement ; Un peu d'histoire sur les
environs de Soap and the City
De la construction par le bon
Roi Dagobert du petit pont Saint-Martin en l'an 629 (sur l'emplacement
de l'actuelle Mairie du 10e) à l'arrivée de la nouvelle gare RER Eole,
notre arrondissement n'a cessé au cours des siècles de se transformer.
Arrondissement des quatre faubourgs (Faubourgs du Temple, Saint-Martin,
Saint-Denis et Poissonnière) il a souvent été le théâtre de grandes
fusillades historiques.
Mais le 10e c'est aussi l'arrondissement des salles de spectacle et des
grands boulevards où, au début du siècle, est né le french cancan. Ses
deux gares, ses quatre hôpitaux, ses deux arcs de triomphe, son canal,
ses anciens couvents sont aujourd'hui les témoins du riche passé de la
capitale.
C'est le 31 décembre 1859 qu'une loi décide de l'extension des limites
de Paris et porte le nombre des arrondissements à vingt contre douze
précédemment. Le 5e devient le 10e arrondissement et prend ses
délimitations actuelles incluant un quartier de l'ancien 3e situé entre
le Faubourg Saint-Denis et le Faubourg Poissonnière.
Le 10e arrondissement qui couvre 286 hectares et compte aujourd'hui 90
000 habitants (soit l'équivalent d'une ville comme Avignon), porte le
nom originel et officiel d'enclos Saint-Laurent. Administrativement, il
comprend quatre quartiers (Saint-Vincent de Paul, Porte Saint-Denis,
Porte Saint-Martin et Hôpital Saint-Louis), quartiers aux communautés
étonnamment variées et aux physionomies bien particulières...
Le "marais" de Paris
 Revenons
quelques siècles en arrière... Les terres du 10e ne sont alors qu'un
paysage de marais. Ici et là quelques jardins cultivés ; l'urbanisme
est quasi inexistant. Mais cette campagne marécageuse, que
traversait, il y a bien longtemps un ancien bras de la Seine, sera
peu à peu asséchée et mise en culture par plusieurs communautés
religieuses. Revenons
quelques siècles en arrière... Les terres du 10e ne sont alors qu'un
paysage de marais. Ici et là quelques jardins cultivés ; l'urbanisme
est quasi inexistant. Mais cette campagne marécageuse, que
traversait, il y a bien longtemps un ancien bras de la Seine, sera
peu à peu asséchée et mise en culture par plusieurs communautés
religieuses.
D'abord dès le XIIème siècle par l'ordre des hospitaliers de
Saint-Lazare qui tiennent une léproserie au nord du Faubourg
Saint-Denis. Cinq siècles plus tard, la lèpre étant en net recul,
s'installent dans la maladrerie de Saint-Lazare, Saint Vincent de
Paul et ses frères, qui ont pour mission d'évangéliser et
d'instruire les campagnes. Les bâtiments de la confrérie sont alors
entourés de fermes. On y cultive le blé, la vigne ainsi que quelques
légumes.
Au XIIIème et aux XIVème siècles, ce sont les religieuses du Couvent
des Filles Dieu qui, au sud-ouest de l'arrondissement, assainissent
les terres qu'elles mettront en culture. En 1360, Charles V décide
la construction de remparts autour de Paris qui relèguent les
futures terres du 10e hors de la capitale.
L'hôpital Saint-Louis
 Depuis
les grandes épidémies de la fin du XVIème siècle, les malades de la
peste ne cessent d'affluer à l'Hôtel Dieu qui, seul, ne peut plus
faire face à la terrible maladie qui se répand dans la ville. Depuis
les grandes épidémies de la fin du XVIème siècle, les malades de la
peste ne cessent d'affluer à l'Hôtel Dieu qui, seul, ne peut plus
faire face à la terrible maladie qui se répand dans la ville.
Le 19 mai 1607, à la suite d'une nouvelle épidémie, le roi Henri IV
ordonne la construction d'un nouvel hôpital, hors des remparts, sur
un terrain isolé, non loin de la butte de Montfaucon et de son
célèbre gibet.
On décide de dédier cet Hôpital à Saint-Louis, mort de la peste en
1270. Henri IV choisit lui-même les plans de l'édifice qui est
achevé en 1611. Les travaux, très coûteux, sont exécutés sous la
direction de l'architecte Claude Vellefaux.
A l'origine l'établissement n'ouvre qu'en période d'épidémie. Puis
au cours des siècles il acquiert une réputation internationale
notamment au XIXème dans le domaine de la dermatologie. C'est
aujourd'hui le plus vieil hôpital parisien et il constitue, avec la
Place des Vosges, la plus belle trace architecturale de l'époque
Henri IV à Paris.
La création des grands
boulevards
 En
juin 1670, Paris s'agrandit, l'enceinte de Charles V est détruite
pour faire place à de nouvelles avenues bordées d'arbres : les
boulevards. Louis XIV fait alors ériger deux Arcs de Triomphe en
l'honneur des victoires remportées sur le Rhin et en Franche-Comté.
C'est ainsi que sont édifiées en 1672 et 1674 la Porte Saint-Denis
et la Porte Saint-Martin, à la gloire du Roi Soleil. En
juin 1670, Paris s'agrandit, l'enceinte de Charles V est détruite
pour faire place à de nouvelles avenues bordées d'arbres : les
boulevards. Louis XIV fait alors ériger deux Arcs de Triomphe en
l'honneur des victoires remportées sur le Rhin et en Franche-Comté.
C'est ainsi que sont édifiées en 1672 et 1674 la Porte Saint-Denis
et la Porte Saint-Martin, à la gloire du Roi Soleil.
La bourgeoisie s'installe peu à peu à proximité des grands
boulevards. Sous le règne de Louis XVI, l'essor important de
l'urbanisation et la spéculation contraignent les communautés
religieuses à céder du terrain.
Les boulevards seront plus tard la scène de violents affrontements
lors des révolutions de 1830, de 1848 et de 1871. De nombreux
combats se déroulent Porte Saint-Denis alors que les faubourgs
s'embrasent. Les arbres des boulevards, abattus, servent de
barricades.
Le canal Saint-Martin
 Quelques
années auparavant, le 4 novembre 1825, est inauguré le Canal
Saint-Martin. La construction de cette voie de transport fluvial,
décidée dès 1802 par Napoléon 1er, permet de relier la Seine à la
Seine en épargnant aux bateaux la traversée de Paris et les méandres
du fleuve. La présence d'un canal est en outre alors un moyen de
résoudre les problèmes d'alimentation en eau de la capitale et
d'embellir Paris. Quelques
années auparavant, le 4 novembre 1825, est inauguré le Canal
Saint-Martin. La construction de cette voie de transport fluvial,
décidée dès 1802 par Napoléon 1er, permet de relier la Seine à la
Seine en épargnant aux bateaux la traversée de Paris et les méandres
du fleuve. La présence d'un canal est en outre alors un moyen de
résoudre les problèmes d'alimentation en eau de la capitale et
d'embellir Paris.
Mais ce n'est qu'en mai 1822 que les travaux sont entrepris. Ils
durent près de quatre années. Long de 4,5 km, reliant le bassin de
la Villette au Port de l'Arsenal (il était prévu à l'origine qu'il
aille jusqu'à Pontoise), le canal Saint-Martin traverse tout le 10e
arrondissement.
Dès l'après-guerre, avec l'arrivée de l'automobile, le trafic de
fret ne cesse de diminuer. Le Canal devient vite "inutile" aux yeux
de la municipalité qui dans les années 60 propose son remplacement
par une autoroute urbaine à deux fois quatre voies ! L'idée est
heureusement abandonnée, son financement étant excessivement
onéreux. Les berges du Canal Saint-Martin sont classées depuis 1990.
L'arrondissement des deux
gares
 Le
XIXème est le siècle de tous les bouleversements. Vingt ans après
l'ouverture du Canal Saint-Martin, est inauguré en 1846
l'embarcadère du chemin de fer du Nord, destiné à desservir les
grandes régions industrielles du Nord de la France. Situé sur les
anciens terrains du clos Saint-Lazare, couvrant trois hectares mais
vite jugée trop exigu, il est démonté onze ans plus tard. Pierre par
pierre, la façade de cette première gare du Nord sera
méticuleusement remontée... à Lille. Le
XIXème est le siècle de tous les bouleversements. Vingt ans après
l'ouverture du Canal Saint-Martin, est inauguré en 1846
l'embarcadère du chemin de fer du Nord, destiné à desservir les
grandes régions industrielles du Nord de la France. Situé sur les
anciens terrains du clos Saint-Lazare, couvrant trois hectares mais
vite jugée trop exigu, il est démonté onze ans plus tard. Pierre par
pierre, la façade de cette première gare du Nord sera
méticuleusement remontée... à Lille.
Les travaux de reconstruction de la seconde et actuelle gare du Nord
sont achevés en 1865 sous la direction de l'architecte Hittorff à
qui l'on doit également l'église Saint-Vincent de Paul. Une querelle
opposant Hittorff au préfet Haussmann ne permettra pas de trouver
pour la Gare du Nord la même harmonie et la même perspective que
pour la Gare de l'Est, située à quelques centaines de mètres de sa
consœur.
L'embarcadère du chemin de fer de l'Est (communément appelé alors
"embarcadère de Strasbourg") date de 1849. C'est la plus ancienne
des grandes gares parisiennes actuelles. Elle est édifiée sur les
terres de l'ancien clos Saint-Laurent. Construite à partir des plans
de l'architecte Duquesney, elle servira de modèle à de nombreuses
gares françaises.
Contrairement aux chemins de fer du Nord, à vocation industrielle et
financés par la compagnie du Baron de Rotschild, la gare de l'Est
est une réalisation de l'État. La ligne du chemin de fer de l'Est a
en effet une vocation stratégique et défensive, essentielle en cas
de mobilisation des troupes. Les guerres de 1870, 1914 et 1940 en
seront la triste démonstration.
La construction de ces deux gares modifie considérablement la
physionomie du 10e qui devient alors l'arrondissement du négoce, des
échanges et de la circulation. La desserte des gares entraîne le
percement de nombreuses voies, notamment le boulevard de Strasbourg
et le boulevard de Magenta. Les quartiers y perdent de leur
quiétude. De grandes manufactures de cristallerie et de porcelaines
s'installent rue de Paradis, alors que les fourreurs fleurissent
dans le sud de l'arrondissement. Avec la venue des industries et le
départ des populations aisées vers le cœur de Paris, le 10e devient
plus populaire. L'essor des théâtres, des cabarets et des grands
cafés donnent à l'arrondissement un nouveau visage.
Le 10e d'aujourd'hui
Resté populaire, le 10e
est au cours de ce siècle devenu plus cosmopolite. Il a accueilli
ces dernières années une forte immigration, essentiellement
africaine, indienne, turque et chinoise. Frappé durement par la
crise, le 10e tente une reconversion. Rue d'Hauteville, les fils de
fourreurs s'intéressent à l'informatique, des entreprises
d'envergure internationale s'implantent dans l'arrondissement... La
population rajeunit et de nombreux artistes et créateurs aménagent
le long du canal Saint-Martin.
Aujourd'hui près de 800 000 personnes transitent quotidiennement
Gare de l'Est et Gare du Nord. Avec l'arrivée de la nouvelle gare
Eole et demain du T.G.V. Est, le 10e sera l'un des plus grands nœuds
ferroviaires du monde
D'importants travaux de rénovation de l'habitat et du patrimoine
architectural, parfois très altéré, restent encore à réaliser.
Enfin, la limitation du trafic automobile est une priorité de
l'arrondissement.
La place centrale du 10e dans Paris, sa mixité sociale et
culturelle, le rajeunissement de sa population, ses nombreux
théâtres, ses hôpitaux renommés dans le monde entier, ses trois
gares et l'arrivée de nombreuses entreprises -concernant des
activités aussi diverses que la publicité, la mode, la création et
même la nouvelle économie-, demeurent des atouts essentiels pour
affronter le 3ème millénaire.
|
rejoignez-nous

join us





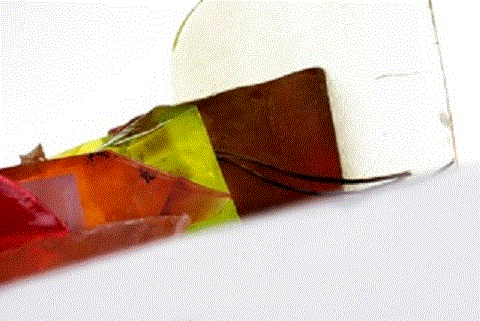








|